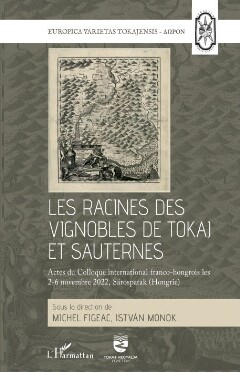Page 127 [127]
Le phénoméne classigue de polarisation autour de la ville ou des fleuves se repére
aisément, mais la richesse du terroir et, en particulier, la présence de sols propices
a la viticulture, constitue ici une clef d’explication importante.
On compte ainsi plusieurs magistrats présents dans le Sauternais, notamment
le long de la vallée du Ciron, 4 hauteur de Bommes, Sauternes et Noaillan. La
présence du cours d’eau facilite non seulement le transport, mais joue aussi, par
ses brumes, un rôle dans la maturation du raisin en contribuant à la formation du
Botrytis Cynerea, champignon responsable de la « pourriture noble ». Jean Duroy
est ainsi l’heureux propriétaire des justices haute, moyenne et basse des paroisses de
Bommes, Sauternes, Cérons et Pujols, et de la maison noble de Saint-Robert, pa¬
roisse de Pujols. La famille ne tarde pas à s’allier avec les Suduirault, qui possèdent
le vignoble qui porte leur nom. Plus au Nord, le Médoc commence aussi à attirer
les magistrats. On rencontre, à Saint-Laurent-Médoc, les Fayet, propriétaires de
la maison noble de Bernos, les Desnanotz, seigneurs de Carnet, et bien sûr les Sé¬
gur. Le long de l'estuaire de la Gironde se succèdent les propriétés des Monneins,
à Bégadan, des Caupos, Cornut, Léglise et Massip à Saint-Christoly-en-Médoc,
les Pontac à Saint-Estèphe avec la maison noble de Pez, puis les Dabadie, sei¬
gneurs de Beychevelle et Lamarque... Citons encore les Dalesmes, seigneurs de
Parempuyre, qui côtoient les Ségur, barons de Margaux, les Pichon, les de Mons,
baron de Soussans et Bessan, le baron d’Agassac Jacques de Pomiés, mais aussi des
officiers moins connus comme Arnaud de Licterie, propriétaire de la maison noble
de Géronille et du fief de Duch, sur les paroisses de Macau et Ludon. Aussi, dés
le second XVII siècle, le Médoc est déjà une terre de prédilection des magistrats
du Parlement. Ces deux régions émergentes ne doivent cependant pas faire oublier
que Messieurs sont aussi surtout présents dans l’Entre-Deux-Mers et le long de la
Garonne, où les vignobles de palus sont florissants.
Cela signifie donc que les magistrats ne fabriquaient pas tous le même vin,
et cette différence s'inscrit à la fois dans la chronologie de la production et dans
la géographie des terroirs. En d’autres termes, on ne produit pas le même vin en
1650 et en 1710, et la qualité varie selon que l’on est propriétaire dans le Sauter¬
nais, l’Entre-Deux-Mers ou le Médoc. Il s’agit de rendre compte d’une réalité
complexe, mouvante, qui nous impose de commencer par décrire l’évolution avant
d'essayer d’en cerner les mécanismes.
Les vignobles bordelais au temps de Louis XIV : la mesure du changement
Vins rouges
Vins blancs
Crus
Montant (en livres
par barrique)
Crus
Montant (en livres
par barrique)
Graves et Médoc
78 à 100
Langon, Bommes,
Sauternes
84 à 105
125