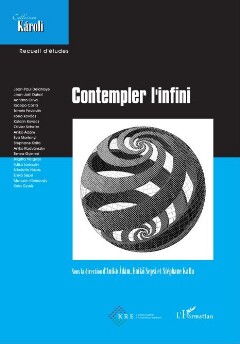Page 159 [159]
DE L'INFINI DU VISAGE À L'INFINI DU LANGAGE -— SUR L'ŒUVRE D'EMMANUEL LÉVINAS
volonté d’une description génétique. C’est ici qu’apparaît la pensée selon laquelle
l'impression originelle du présent ne se révèle que dans un processus de
modification rétentionnelle, ce qui nous conduit à présumer que dans l'impression
originelle nous avons affaire à la genèse postérieure et continue de la constitution
temporelle de l’objet temporel et non plus à la stabilité statique d’un objet tout
fait. Le fait que l’impression originelle ne se manifeste jamais en soi, uniquement
dans sa modification rétentionnelle postérieure, c’est-à-dire dans une sorte de
décalage constitutif indélébile (v. le motif proprement husserlien de la Nach¬
träglichkeit), a aussi pour conséquence que la différence de la rétention « précède »,
dans un certain sens, l'identité de l'impression originelle subséquemment donnée.
En prenant donc en considération que l’altérité de la rétention sollicite, ébranle
(pour) toujours l’identité de l'impression originelle du présent, l'originalité ne
s'associe pas à l'impression du présent mais à la rétention, c’est-à-dire qu'il s’agit
là d’une sorte de rétention — et non plus d’une impression — originelle. De toute
manière, c’est autour de cette rétention originelle conçue comme la postériorité
ou le décalage originel de la temporalisation que la conception diachronique du
temps de l’Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence se constitue. C’est cette
dimension temporelle particulière, la rétention fondamentale qui se trouve à la
base de ce passé qui, en empruntant la formulation de Merleau-Ponty, « jamais
ne fut présent” », et c'est pour la description de cette même dimension temporelle
que nous nous servons de la fameuse notion de trace qui, par son essence, n’est
jamais l'empreinte d’une présence passée.
Nous devons donc nous demander quel est l'impact de cette résultante
théorique originale de l'analyse génétique du temps, c’est-à-dire de l’idée de la
rétention originelle sur la phénoménologie du sujet, du rapport de responsabilité
à autrui, de l'expérience du langage et du sens comme elle se voit être exposée
dans cette deuxième grande œuvre lévinassienne. La dimension temporelle citée
ci-dessus a également pour conséquence logique que la conscience du sujet
diachronique ne peut être non plus présente à soi, car elle ne peut se présenter
à soi qu'ultérieurement, dans un décalage originel par rapport à l'actualité du
flux de conscience: « [d]ans la conscience de soi, il n’y a plus présence de soi à
soil,» En même temps, dans la pensée lévinassienne l’acte de la responsabilité
pour autrui est également décrit par cette même temporalité diachronique. (Je
ne me souviens pas, et je ne peux pas représenter l’instant passé de cette
responsabilité originelle, car il n’a jamais été présent comme tel, même si je suis
* Lévinas, Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence. Op. cit., p. 45. L'idée de la rétention originelle
apparaît déjà dans les notes de travail de l'écrit inachevé de Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et
Vinvisible. (Paris, Gallimard, 1964, p. 238, 244 et 249).
10 Levinas, ibidem, p. 88.
¢ 157 +