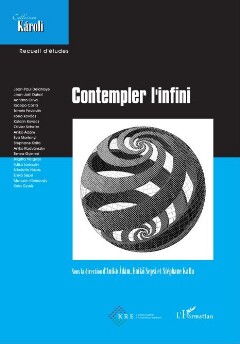Oldal 78 [78]
Katalin Kovács
Les « nuits » de Georges de La Tour: miroir,
vanité et contemplation de l’infini
L'objectif de notre article consiste à démontrer par des exemples visuels (les ta¬
bleaux d’un peintre du 17° siècle, Georges de La Tour) la relation intime entre la
contemplation et l'infini. Pour ce faire, nous limiterons notre analyse aux tableaux
nocturnes et religieux du peintre, qui proviennent des quinze dernières années
de sa période de création. Nous considérerons les toiles qui ont pour thème le
repentir, allant de pair avec la méditation silencieuse : les Madeleine de La Tour.
En même temps, nous tenterons de répondre à la question de savoir pourquoi
les scènes nocturnes de La Tour — éclairées à la chandelle et traitant de sujets
non seulement religieux mais aussi profanes — suggèrent même au spectateur
peu averti le sentiment de contemplation de l'infini. Selon notre hypothèse, ce
sentiment provient en grande partie de la « manière ténébreuse » de La Tour,
différente de celle du Caravage, tout aussi bien que des peintres lorrains qui lui
étaient contemporains. À côté des attributs facilement déchiffrables (comme le
miroir ou le crâne), c’est encore cette manière qui apparente les toiles de La Tour
à la peinture des Vanités.
À propos des « nuits » de La Tour : influences nordiques
et caravagesques
Comme le remarque l'historien de l’art Jacques Thuillier, Georges de La Tour est
un véritable «triomphe de l’histoire de l’art» moderne car le peintre avait som¬
bré dans l'oubli pendant trois siécles'. Ses tableaux étaient attribués à d’autres
peintres de son époque (Louis Le Nain, Zurbarän, Velézquez ou Murillo) et
l’œuvre de La Tour n’a été découvert qu’en 1934, lorsqu'une exposition (Les
peintres de la réalité en France au 17 siècle) a été organisée par Paul Jamot au
! Jacques Thuillier, Propos sur La Tour, le Nain, Poussin, Le Brun. Paris, Réunion des Musées
Nationaux, 1991, p. 13
+ 76 +