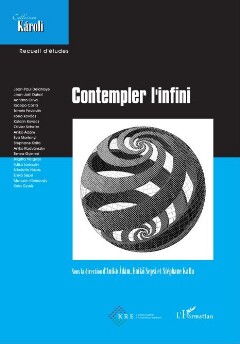Oldal 79 [79]
LES « NUITS » DE GEORGES DE LA TOUR: MIROIR, VANITE ET CONTEMPLATION DE L'INFINI
musée de l’Orangerie a Paris. Une autre remarque de Thuillier mérite également
notre attention: il constate que dans sa premiére période de création, a savoir
avant 1635, La Tour est « un beau peintre», un peintre admirable, mais qu’il
devient dans ses quinze dernières années un « grand peintre »?. C’est la période
de ses « nuits », lorsque la « manière nocturne » prendra le dessus dans sa pein¬
ture par rapport à la «manière diurne », qui a abouti à des scènes de genre riches
en détails et exécutées avec un grand réalisme.
Le partage des tableaux de La Tour en images nocturnes et diurnes est
cependant moins évident qu'il ne le semble, parce que ces deux manières de
création ne se succèdent pas tout à fait chronologiquement dans son œuvre. Tout
au long de son itinéraire de peintre, La Tour a en effet simultanément cultivé la
«manière diurne » et la «manière nocturne », et ce n’est que dans ses dix dernières
années qu’il se spécialise dans les nocturnes et devient «La Tour des nuits ».
Avec la manière plus rapide et brillante de ses tableaux diurnes contraste la
manière sombre et dépouillée de ses «nuits ». Celles-ci sont souvent des
compositions monumentales, réduites à des personnages-types et à un nombre
restreint des accessoires. Cette tendance de réduction va de pair avec une
simplification bien visible des moyens picturaux et aboutit à une peinture
silencieuse.
La question qui se pose est celle de savoir pourquoi La Tour a quitté, vers la
fin de sa vie, la manière « diurne » pour se tourner quasi-exclusivement vers les
nocturnes. Comme tous les phénomènes, celui-ci a également plusieurs causes,
relevant tant des tendances artistiques générales de l’époque que de l’évolution
personnelle et spirituelle de La Tour. Parmi ces causes, il faut mentionner tout
d’abord la vogue de la peinture des « nuits » dans la première moitié du 17° siècle.
L'âge baroque connaît la prolifération des tableaux de nuit dans la peinture
européenne, en Italie tout comme dans les pays du Nord. C’est vers les années
1630 que cette vogue atteint la France: le foyer artistique de la Lorraine (dont
La Tour est originaire), mais aussi les autres régions. Du point de vue artistique,
la Lorraine jouissait en effet d’un rôle privilégié, grâce à sa situation de carrefour
entre l’Italie et les Pays-Bas?. Parmi les peintres de cette région, Jacques Bellange
et Jean Leclerc cultivent cette manière et, parmi les peintres provençaux, Trophime
Bigot est le plus important, ses sujets montrant peut-être le plus d’affinités avec
ceux de La Tour“. Effectivement, les deux peintres mettent en scène dans leurs
? Ibidem, p. 41.
3 Jean-Claude Boyer, « La Lorraine des peintres au temps de Georges de La Tour ». In Paulette Choné
(dir.), Läge dor du nocturne. Paris, Gallimard, 2001, p. 63-90.
* Jacques Thuillier voit une « parente spirituelle» entre les sujets nocturnes (tant religieux que
profanes) de La Tour et de Bigot. V. Thuillier, op. cit., p. 29.
.77 »