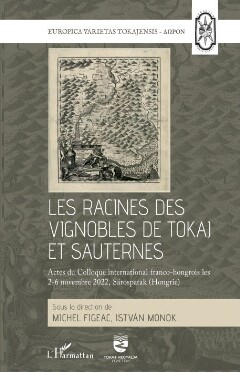Page 135 [135]
déchausser, faire les provains, récurer les trois fossés, bécher la vimiére?", couper
les vimes, faire les sarments, les amasser et les porter avec la méchante sécaille,
travailler pour les vendanges et laisser les breuvages faits. En échange, il reçoit un
salaire de 180 livres par an. Il s’agit donc d’un contrat de travail agricole, réguliè¬
rement utilisé par le président Pichon“, mais il se rencontre aussi chez le conseil¬
ler Jean-Baptiste-Simon Desnanotz, pour une maison appelée « à la Tourade »,
consistant en deux bourdieux, paroisse de Floirac#!. Toutefois, en étudiant ce type
de contrat, nous avons rencontré des accords présentant des caractéristiques simi¬
laires, sous la dénomination de « bail à faisandure ». Le président Bernard de Pi¬
chon conclut avec Jacques Jouqueau, brassier de Bassens, un contrat par lequel ledit
Jouqueau s'engage à « prendre à faisandure les vignes dépendant de la métairie de
la Gardette, « à Lalande », à Bassens », pour une durée de deux ans. Le brassier
doit tailler, donner quatre façons de pique et entretenir les fossés en échange d’un
salaire de 250 livres par an, versé à l'avancement du travail. On a donc ici une
acception du terme très différente de celle donnée par Marcel Lachiver”, selon
lequel le bail à faisandure désigne, « en Bordelais, (un) bail qui s'apparente au mé¬
tayage, mais qui prévoit en général une redevance en nature inférieure à la moitié,
et qui dispense le concédant de participer aux frais de l'exploitation. Conclu pour
trois à neuf ans il est, dans ce dernier cas, reconductible de neuf en neuf ans, et se
confond avec le bail à gaudence ». De fait, cette terminologie s’appliquerait plutôt
aux baux à faisandure passés en Bordelais au Moyen-Age‘ ou en Haut-Médoc
au XVI siecle. Sy apparente aussi le contrat conclu entre Isabeau de Lalanne,
veuve du président à mortier Salomon de Virelade, et Augerie Marsau, vigneron
des Graves®. Le preneur s'engage à travailler les vignes de la maison noble des
Graves, paroisse de Mérignac, pour une durée de cinq ans. Le détail des tâches
est énoncé, et ouvre droit à un salaire de 180 livres. Mais en outre, le preneur aura
droit à la moitié de la récolte de vin, à charge de faire les vendanges à ses dépens
et de participer à l’achat de l'œuvre et vime. Isabeau de Lalanne doit fournir un
logement et avancer 400 livres pour les frais de culture, dont elle se rembourse¬
ra sur la récolte de vin. La confrontation de ces différents exemples tend donc à
montrer que le contrat de faisandure serait une sorte de moyen terme entre le mé¬
tayage et le système du prix-fait. Toutefois, très souvent, ces contrats ne faisaient
pas obligatoirement l’objet d’actes chez notaire ; on les retrouvait en fait dans les
livres de comptes des magistrats, mais il faut reconnaître que pour le XVII: siècle,
# Vimière ou vimenière : endroit planté de vime (osier).
© Voir aussi AD 33, 3E 7629, f° 205, 13/01/1669, contrat de prix fait ; AD 33, 3E 7634, f° 100v, 03/06/1674,
idem ; AD 33, 3E 7634, f° 229v, 16/12/1674, idem.
4 AD 33, C 4851, 02/12/1713, déclaration.
# Marcel Lachiver, Dictionnaire du monde rural, les mots du passé, Paris, Fayard, 1997, p. 756.
# Jean Barennes, Viticulture et vinification en Bordelais au Moyen Age, Bordeaux, M. Mounastre Picamilh,
1912, p. 44.
4 Jean Cavignac, op. cit., p. 79-92.
# AD 33,3 E 7634, f° 195v, 19/10/1674, bail à faisandure. Voir aussi AD 33, 3E 7632, f° 53v, 25/04/1672,
bail à faisandure.
133