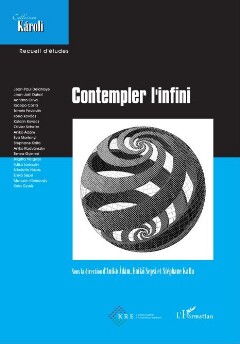Page 21 [21]
LES GRECS ONT-ILS CONTEMPLÉ L'INFINI
implicitement le modèle de la corde vibrante qu’un découpage en des points
précis — qui en constituent des limites —, comme deux, un demi, trois demis ou
deux tiers, permet de faire sonner à l’octave ou a la quinte, produisant ainsi une
harmonie musicale, qui constituera la base théorique du postulat de la ma¬
thématicité’ du cosmos.
Il est donc clair que l’infini ne pouvait étre en aucune facon un objet de
contemplation pour les Grecs, mais il serait sans doute illusoire de voir simplement
dans cette absence la marque d’un progrès dont nous serions les bénéficiaires :
nous verrions ce que les Grecs ne voyaient pas. On doit retourner la perspective:
si les Grecs refusaient de voir l'infini parce qu’ils considéraient qu’il n’y avait rien
à voir, ne faudrait-il pas se demander si l'infini n’est pas une fiction — sinon
positivement innommable, du moins innommable positivement — que nous
ferions semblant de voir ? Autrement dit, l'infini est-il une illusion ? Derrière son
apparente évidence, cette question n’a pas de sens pour l’héritier de Foucault que
je suis : la question est, en fait, de savoir dans quelle épistèmè le concept d’infini
peut incarner un sens. Il ne s’agit pas de savoir si on peut, on non, contempler
l'infini, mais quelles sont les structures épistémiques qui en font surgir l'expression,
et en donnent au moins l'impression, sinon l'illusion, de la possibilité.
Piège pour le raisonnement, l'infini ne pouvait donc être conçu par les Grecs
comme une réalité positive.
Qu'en est-il de la contemplation ? Ici encore, le décalage entre les configurations
épistémiques risque d’être source de nombreux malentendus. Pourtant, si l'infini
est effectivement un concept quelque peu étrange, la contemplation semble être
une attitude transculturelle. Dans toutes les sociétés, on contemple les beautés
naturelles, le ciel, le spectacle grandiose que peut donner un coucher de soleil.
Cela devrait certes suffire à faire de la contemplation un comportement premier
qui constituerait une constante de l’humanité; pourtant ce n’est pas l’acte de
contemplation qui nous intéresse ici, mais la manière dont on le conceptualise,
et en cela les décalages culturels sont pleinement opérants.
Le lexique de la pensée grecque paraît faire une place importante à la
contemplation: Ozáouot, Oewpsiív et méme, de manière peut-être un peu moins
directe, voeiv, renvoient à quelque chose comme la contemplation. En tout cas
les deux premiers, dans lesquels on reconnaît la racine? que nous retrouvons
dans notre théâtre, peuvent se traduire par contempler. On saisit immédiatement
la difficulté qui surgit: les dérivés les plus connus du verbe theôrein, Bewpia et
Oewpnua sont devenus notre théorie et notre théorème, qui se situent justement
1 L'emploi de ce terme constitue un néologisme commode, que j’ai utilisé dans des articles antérieurs.
? Notons qu'il n’y a aucune parenté étymologique avec theos, dieu.
«19 «