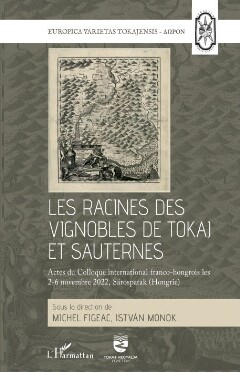OCR
très particulier gui ne ressemble a rien de ce gue je connais? s. La distinction est reprise par John Locke qui, de passage ä Bordeaux, sempresse d’aller visiter le domaine, en 1677-1678. II faut dire que le philosophe était un habitué de la « taverne » Chez Pontac, sans doute le « premier restaurant distingué de Londres » ouvert par la famille bordelaise. Citons enfin les remarques de l'écrivain anglais John Evelyn, qui notait, le 13 juillet 1683, avoir eu « une trés longue conversation avec M. de Pontac. Ce gentilhomme, qui est le fils du célébre et avisé président de Bordeaux, est le propriétaire des excellents vignobles de Pontac et de Haut-Brion, d’oü proviennent nos plus fins et meilleurs vins de Bordeaux” ». Ainsi, la puissante mutation qui se produit au tournant des XVII* et XVIII: siècles a été amorcée par des propriétés pionnières comme celle de Haut-Brion. À l'inverse, si certains furent en avance sur cette mutation, d’autres furent en retard et s’en tinrent à une production routinière. Les magistrats tenaient les meilleurs vignobles, mais tous ne possédaient cependant pas des crus d'exception et en l'espèce, l'arbre a souvent caché la forêt, car pour un seigneur des vignes, combien de « vignerons » ? La carte des propriétés des magistrats a montré une forte concentration dans la pointe de l’Entre-Deux-Mers, vers Ambès, Ambarès et Montferrand, puis sur la rive droite de la Garonne, à hauteur de Cenon, Floirac, Bouliac, zone qui correspond aux premières côtes de Bordeaux, et enfin le long de la Garonne, de l’Tsle Saint-Georges à Cadillac. Or, si l’on reprend le tarif de 1647, on a là affaire à des vins qui se vendaient le plus souvent peu chers, à part la notable exception des vignobles de palus. Mais le temps ne joua pas en faveur de ces terroirs. La Bourdonnaye* ne s’y était pas trompé : « Ce qui fait la grande abondance des vins, ce sont ceux d’Entre-Deux-Mers, des palus du côté de Garonne, au-dessus de Bordeaux, jusque vers Barsac en Cubzagais, Fronsadais et vers Libourne, au-delà de la Dordogne », ajoutant que très souvent, ce vin était en fait destiné à la distillation. Les vignes de l’Entre-Deux-Mers produisaient en effet un vin de faible qualité mais il était très abondant. Aussi servait-il à la fabrication d’eau-de-vie, tradition de distillation rurale à but commercial qui se perpétue dans la région durant le XVIII: siècle*!. Les inventaires après décès mettent parfois à jour cette pratique. Léonard François de Gombault*? possède par exemple, dans sa maison noble de La Rue, paroisse de Notre-Dame de la Chapelle d’Ambès, « deux chaudières de cuivre rouge à faire de l’eau-de-vie, garnies de ses parties et chapeau de cuivre, portes de fer ». Le plus souvent, c'était cependant les négociants hollandais qui se chargeaient de cette opération, une fois les vins acheminés jusqu’à Amsterdam. Durant le règne de Louis XIV, il se produit donc une mutation du vin borde7 Mynors Bright et John Warrington (eds), Diary of Samuel Pepys, London, Dent, 1953, p. 83. 28 John Locke, Œuvres complètes, Paris, F. Didot, 1839, t. X, p. 329. 39 Diary of Jobn Evelyn, cité par René Pijassou, op. cit., p. 340. % AN, KK 1317, mémoire de la généralité de Bordeaux, par La Bourdonnaye. 31 Louis Cullen, « Bordeaux dans le cadre du commerce international des eaux-de-vie au XVIII siécle », dans Bordeaux, porte océane, Bordeaux, FHSO, 1999, t. II, p. 35-42. 2 AD 33, 3 E 2028, 22/06/1699, inventaire du conseiller Léonard Francois de Gombault. 131
Structural
Custom
Image Metadata
- Image width
- 1831 px
- Image height
- 2835 px
- Image resolution
- 300 px/inch
- Original File Size
- 1.39 MB
- Permalink to jpg
- 022_000054/0132.jpg
- Permalink to ocr
- 022_000054/0132.ocr