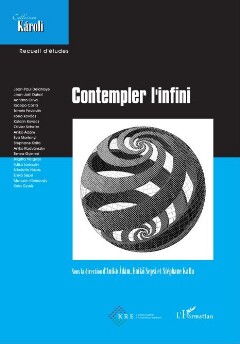Oldal 71 [71]
CONTEMPLER LINFINI : LES MÉDITATIONS RELIGIEUSES DE FRANGOIS II RÁKÓCZI
comme la Confession. Ainsi, ce sont ces deux parties de l’histoire d’une vie, ra¬
contées séparément, qui constituent l’ensemble du bilan de conscience réalisé
avec la conviction inébranlable que tout suit la volonté de la puissance divine
omniprésente.
Les deux ouvrages ont été rédigés dans deux langues différentes (latin pour
le premier, confirmant l'importance du modèle augustinien, et français pour le
deuxième). La relation entre le latin et le genre de la confession paraît évident,
tandis que le choix du français prête à discussion dans les interprétations. Les
historiens spécialistes de cette époque et de l’activite de Räköczi? argumentent
pour prouver que le fait d’avoir choisi de rédiger ses mémoires en français traduit
l'intention du prince de vouloir recommencer la lutte avec l’aide de la France. Il
aurait écrit ses souvenirs pour plaider la cause des Hongrois, mais - selon eux
- dans une perspective concrète en vue de solliciter de l’aide financière et politique.
À mon avis, cette hypothèse ne prend pas suffisamment en compte un autre fait
qui est que, tout au long de ce siècle, il fallait pour expliquer et commenter
l’histoire du soulèvement pour l'opinion publique européenne recourir au français,
qui était la langue commune de la communication en Europef. Dans mon
interprétation, la chronique de cette guerre est un ouvrage politique et
historique aussi, mais écrite dans un esprit religieux qui fait abstraction des
conjonctures historiques. Les deux textes autobiographiques se distinguent en
fait quant à leur finalité séculaire, par conséquent le public visé n’est pas le même:
le prince s'adresse à ses contemporains aussi pour l’un, tandis qu'il ne prend en
considération que la postérité dans l’autre. Le fond des deux textes reste pourtant
identique et prend sa source dans la contemplation. C’est la foi profonde du prince
en Dieu, incarnation de l'infini et de l'absolu qui lui fait voir tout sous le signe
de la religion et ce trait unit les deux textes malgré certaines différences plus
apparentes et superficielles que réelles. Une analyse focalisée sur la contemplation
des événements terrestres dans l'optique de l'éternité montre indubitablement
qu'il s’agit partout de la même conception. Par conséquent, de ce point de vue,
il était justifié d'intégrer les deux ouvrages dans une chronologie linéaire’ en
leur rétablissant une continuité que l’auteur n’a pas voulu exprimer de façon
explicite. La question se pose alors de nouveau à juste titre, pourquoi avoir choisi
deux langues et deux genres différents ? Pour résoudre le problème, il faut
souligner la distinction subtile concernant l'identité du sujet qui écrit. Il est
capital, pour éclairer le rapport de ces deux textes, de constater que Räkéczi
5 Notamment quelques éminents connaisseurs de son œuvre, comme Âgnes R. Vérkonyi és Béla
Kôpeczi, auteurs de monographies magistrales et de nombreuses études sur le sujet.
5 V. Marc Fumaroli, Quand l'Europe parlait français. Paris, Éd. De Fallois, 2001.
7 V. L'édition publiée par Corvina: Lautobiographie d'un prince rebelle, Budapest, Corvina, 1977.
+69 +