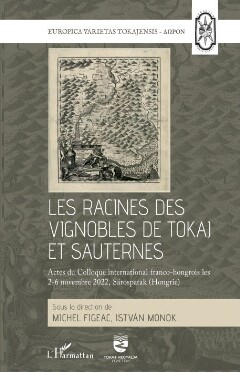OCR
que d’une faveur temporaire puisque dans la seconde moitié du XVI: siècle’, le vin de Graves valait plus cher que celui de palus. De plus, certaines régions semblent avoir des productions très différentes de celles pratiquées par la suite, le terroir de Saint-Macaire donnant un honnête vin rougef tandis que Saint-Émilion livre un vin blanc plutôt médiocre. Par ailleurs, on aura remarqué que le classement établit une hiérarchie des terroirs, mais non des « crus ». On évoque des régions plutôt que des domaines appartenant à tel ou tel propriétaire. Ceci n’exclue pas une certaine précision puisque l'on distingue dix-sept catégories, au sein desquelles l’amplitude laisse la place pour toute une gamme de nuances. Celle-ci peut avoir plusieurs significations. Forte dans les meilleurs terroirs, elle tient au fait que plus le prix est élevé, plus la nuance peut être fine. En revanche, les écarts importants de régions comme le Blayais, Saint-Macaire ou Sainte-Croix-du-Mont, indiquent que la production y est très hétérogène. Il est dès lors probable qu’au sein de ces zones, des mutations ponctuelles sont en cours. Un demi-siècle plus tard, la classification semble avoir un peu changé. Voici le jugement porté en 1698 par l’intendant Bazin de Bezons : « Il y a trois cantons fort renommés dans l’élection de Bordeaux, dont les vins se vendent chers. Le plus considérable et le meilleur sont les Graves, qui sont aux environs de la ville de Bordeaux ; il en coûte beaucoup pour les cultiver. Le second canton renommé pour les vins est le Médoc, ce sont vins rouges comme ceux de Graves... Il y a beaucoup de lieux en Médoc, dont les vins sont estimés et se vendent bien. Le troisième canton des vins bien plus estimés sont ceux des environs de Langon, Barsac et autres lieux proches de la Garonne. Ce sont des vins blancs qui se vendent chers”. ». Si les vins de palus ne sont plus à la mode, les blancs liquoreux affirment leur domination et la zone autrefois subdivisée en différentes régions ne forment plus qu'un seul ensemble, ce qui pourrait signifier que le produit a d’ores et déjà une identité affirmée et que les régions restées en retrait au milieu du XVIT: siècle ont désormais suivi l'exemple de Sauternes. D'une certaine manière, le processus est inverse pour les vins rouges car les Graves et le Médoc ne font plus partie d’une même catégorie. [ls ont désormais une identité propre, les Graves l’emportant nettement sur le Médoc en termes de qualité, mais l’intendant met en exergue la question de la rentabilité du premier, où les frais de culture sont élevés. 7 Jean Cavignac, « La vigne en Haut-Médoc au XVI siècle », dans Vins et vignobles d'Aquitaine, Bordeaux, FHSO, 1970, p. 79-92, en particulier p. 89. 8 Jusqu'au XIX: siècle, Saint-Macaire produit des vins rouges colorés et corsés. La crise phylloxérique de 1869 et la demande hollandaise suscitent une reconversion rapide vers les vins blancs. Jean-Claude Hinnewinkel, « Les usages locaux, loyaux et constants dans les appellations viticoles du nord de l’Aquitaine. Les bases des aires d’appellations d’origine », dans Le vin a travers les âges, produit de qualité, agent économique, Bordeaux, Féret, 2001, p. 133-149. * Archives départementales de la Gironde (désormais AD 33), 4] 181 ou Archives de Bordeaux Métropole, ms. 216, mémoire de l’intendant Bazin de Bezons sur la généralité de Guyenne, 1698, édité par Laurent Coste (éd.), L'intendance de Bordeaux à la fin du XVIF siècle. Édition critique du mémoire « pour l'instruction du duc de Bourgogne, Paris, CTHS, 2022. 127
Structural
Custom
Image Metadata
- Image width
- 1831 px
- Image height
- 2835 px
- Image resolution
- 300 px/inch
- Original File Size
- 1.35 MB
- Permalink to jpg
- 022_000054/0128.jpg
- Permalink to ocr
- 022_000054/0128.ocr