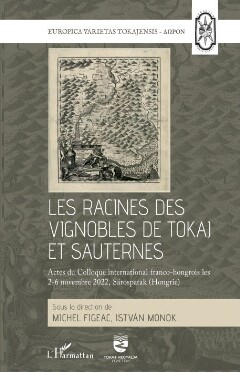Oldal 96 [96]
plus large de consommateurs et soumis parfois á des fraudes. Ces vins répondent
aussi sans doute à la demande pour des vins légèrement moins sucrés que les mus¬
cats pour des usages, comme nous allons le voir, un peu différents. En 1786, la
cave de l’évêque de Limoges, Duplessis d’Argentré, est assez caractéristique en
ce domaine des goûts des élites à la veille de la Révolution puisqu'on y trouve de
grandes quantités de vins d’Espagne et du vin de Chypre, mais aussi 150 bouteilles
de Sauternes, des vins de Rivesaltes et des vins de Bergerac « doux », sans doute de
la région de Monbazillac®.
Les manières de boire les vins doux confirment qu’il s’agit de vins à part qui
s'inscrivent dans le rituel de repas raffinés. Comme pour les autres vins, l'usage
qui prévaut pendant longtemps au cours des repas d’apparat est de ne pas disposer
les verres et les bouteilles sur les tables, mais de faire appel à des domestiques qui
assurent le service des boissons à la demande. Cette pratique qui perdure dans
les années 1770 semble parfois gêner les convives comme l'écrivain russe Denis
Fonvizine.
« On se met à table à neuf heures et demie et l’on y reste plus d’une heure. On
sert une table d'environ soixante-dix couverts [...] Chaque convive a un valet
debout derrière sa chaise. S’il n’a pas de laquais, ce malheureux invité n’a plus
qu'à mourir de faim et de soif. I] ne peut pas en être autrement : selon l’usage
du pays, on ne fait pas circuler les plats autour de la table, mais il faut regarder
tout ce qui est sur la table et demander par l’intermédiaire d’un laquais ce qui
vous aura plu. Devant le couvert, on ne met ni vin ni eau et, si l’on a soif, il faut
à chaque fois envoyer son serviteur à l'office. [...] J'ai demandé pourquoi on ne
mettait pas de vin ni d’eau devant les couverts. On n'a répondu que c’était par
économie : car on a remarqué que si l’on mettait une bouteille sur la table, un
seul convive la boirait toute entière et que si on ne l’y mettait pas, une bouteille
suffisait pour cinq personnes. 5".
La dégustation du vin, au sens où nous l’entendons aujourd’hui, peut donc dif¬
ficilement se faire puisqu'il faut vider son verre d’une traite. Le traité de civilité
d'Antoine Courtin souligne d’ailleurs la nécessite de s’y conformer : « Cela tient
trop de familier de goûter le vin, & de boire son verre à deux ou trois reprises ; il
faut le boire d’une haleine & posément »”7. Mais, d’autres témoignages suggèrent
que les élites européennes sont de plus en plus réticentes à partager un verre com¬
mun comme le montre l’abbé Kitowicz dans sa description de la cour de Pologne.
« Ils buvaient l’un après l’autre dans une seule coupe, n'étant pas du tout dégou¬
tés par les gouttes de la boisson qui tombaient dans la coupe des moustaches de
chaque buveur. Même les Dames en buvaient sans aucune aversion n’hésitant
pas à toucher ce récipient avec leurs lèvres délicates. Mais aussitôt, quand les
verres et coupes en verre se sont établis, s’introduit alors le dégoût pour la
5 Archives départementales de la Haute-Vienne, 1 G 238.
5% Denis Fonvizine, Lettres de France (1777-1778), éd. H. Grasse, Paris, 1995, p. 81-85.
7 Antoine de Courtin, Nouveau traité de la civilité qui se pratique en France parmi les honnétes-gens, Paris,
1728, p.178.
94